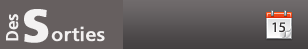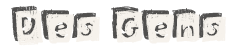- Accueil
- Histoire & mémoire
- Contributions
- L’invention de la cinématographie à Belleville
1241 visites sur cet article
L’invention de la cinématographie à Belleville
L’article ici présenté est fondé sur le texte, augmenté, de la conférence prononcée par Maxime BRAQUET dans la grande salle de l’immeuble historique de la Société pour l’encouragement de l’industrie nationale, 4, place de Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e, le 18 octobre 2019, dans le cadre du colloque Les ingénieurs font leur cinéma.
Cette invention : le cinéma comme outil, si vous voulez, et non pas comme film de cinéma — chose qui interviendra dans un second temps —, cette invention, donc, s’est accomplie à la charnière des deux siècles précédents. On ne fait ici que le rappeler. Même si la machine d’Auguste et Louis Lumière a emporté la palme de l’appareil le plus ingénieux et le plus pratique en matière d’enregistrement de photographies de vues animées et de leur projection, c’est d’une gestation en fait mondiale qu’il s’agit. Les géniteurs sont d’un peu partout : Danemark, Ecosse… mais surtout des Etats-Unis (Thomas Edison, William K. Dickson), d’Angleterre (William Friese-Greene, Robert W. Paul), d’Allemagne (Oskar Messter, Max Skladanowsky) et de France. Sans chauvinisme excessif, il faut bien dire que la France a particulièrement donné au corps des constructeurs, ingénieurs, techniciens et autres industriels accoucheurs de la cinématographie. Bien sûr, on pense tout de suite aux deux frères lyonnais mais la majorité des autres oeuvra en région parisienne : Auguste Baron à Asnières ; François-Ambroise Parnaland et Charles Jourjon, à Epinay-sur-Seine ; Charles Pathé à Chatou, Vincennes et Joinville-le-Pont et Georges Méliès à Montreuil. Sur Paris même, on a Georges Demenÿ et Jules Carpentier et, plus précisément à Belleville, Pierre-Victor Continsouza et René Bunzli.
Alors, si nous ne sommes pas un spécialiste de l’histoire du cinéma, si nous n’avons guère de lumière sur la technique, l’évolution des technologies et le développement des entreprises industrielles, nous pouvons cependant, comme historien de Belleville, illustrer l’expérience de l’un des plus remarquables ingénieurs du cinéma, Léon Gaumont, qui a choisi d’installer son unité de fabrication à côté du parc des Buttes-Chaumont.
Léon Gaumont, né en 1864, est au plein sens du mot un autodidacte, il faut bien marquer cela. Il n’a pas effectué de hautes études d’ingénieur ni ne reçut une formation professionnelle spéciale.
Un peu de biographie [1]
Enfant d’une famille très modeste, il dut interrompre sa scolarité à 16 ans. Il avait cependant un caractère fortement trempé et un gros appétit de réussite. Très tôt, il manifesta de l’intérêt pour les machines, particulièrement dans le domaine optique. On conserve de lui des carnets de dessins où, tout jeune homme, il portait déjà attention aux problèmes de l’association du son et de la couleur aux images photographiques. Bref, à tout ce qui, plus tard, entre 1895 et 1930, constituera l’implication la plus motivée de Léon Gaumont dans les travaux de sa propre entreprise. Il conservera toute la vie l’esprit battant et ambitieux des débuts.

Léon Gaumont jeune marié, en 1888. © DR
Il suivit certes des cours du soir libres, mais c’est chez son employeur Jules Carpentier, éminent fabricant et commerçant de jumelles et d’appareils photographiques, que, petit à petit à compter de 1881, il apprendra vraiment, « sur le tas », comme on dit, l’ingénierie de l’optique de précision. Il n’avait pourtant qu’un poste de bureau mais fréquentait beaucoup les ateliers. C’est là aussi, en même temps, chez Carpentier, qu’il acquerra les bases de la gestion d’entreprise.
C’est un homme bien formé que l’on retrouve, en 1894, fondé de pouvoir d’une société commercialisant aussi des appareils optiques, le Comptoir général de la photographie (CGP), de Félix-Max Richard, dont la boutique ouvre sur la rue Saint-Roch, dans le quartier de la place Vendôme. L’entreprise Richard avait un contrat particulier avec l’inventeur et constructeur Georges Demenÿ qui, à l’époque, perfectionnait deux appareils précurseurs de la cinématographie : le Biographe et le Bioscope, issus de son expérience de chronophotographie avec le physiologiste Jules-Etienne Marey.

Léon Gaumont en 1895. © DR
A l’été de 1895, l’adjoint de Richard, prenant la succession de son patron, devient propriétaire de l’affaire et fonde pour elle une société en commandite, la L. Gaumont et Cie, où participe au capital un certain Gustave Eiffel [2]. Cet ingénieur génial, que nous ne prendrons pas la peine de présenter, avait appris, comme client chez Carpentier et Richard, à connaître le sérieux de Léon Gaumont. Il crut en l’accomplissement de l’ambition de son jeune partenaire. L’année suivante encore, Gaumont ouvrait un site industriel à Belleville.
Belleville
Comment ce choix de Belleville s’est-il fait ? Par pure opportunité car, comme place d’industrie, Belleville n’offrait pas les avantages particuliers dont profitaient en revanche la Villette, Grenelle, les Batignolles, la Roquette, la Chapelle, Popincourt, une grande partie des XIIIe et XIV arrondissements de Paris. Pourquoi ?

Voie typique du vieux Belleville, la rue de la Villette, ici clichée en 1905. © Carte postale du domaine public
Juché sur un site montueux, presque enclavé, Belleville ne bénéficiait pas, contrairement à tous ces quartiers cités, de la proximité des voies majeures d’alimentation des usines en matières premières que constituent les lignes de chemin de fer, les canaux et les grandes routes carrossables reliant la capitale aux provinces minières ou même agricoles. Belleville est une terre ouvrière, riche en main-d’oeuvre, mais son industrie est de moyenne importance, constituée d’une multitude d’ateliers et de chantiers employant rarement plus 100 travailleurs même quand les unités d’activité sont des manufactures et des usines. Et puis, il y a les échoppes artisanales, témoins encore d’un passé pré-industriel. Existait dans le Belleville des années de la naissance du cinéma une grande spécialité : l’industrie de la fabrication des chaussures (et les métiers du cuir en général). En ce domaine, très fourni en professionnels, Belleville a même compté entre ses murs la plus grosse usine de toute la France autour de 1900 : les établissements Dressoir, employant plus de 1 000 ouvriers et ouvrières et sis au bord des rues Rébeval et du Général-Lasalle, dans ce que nous sommes convenus d’appeler le bas Belleville occidental.
Peu éloignés de ce site, il y avait deux centres de fabrication assez importants, les établissements de Jules Richard (le frère aîné du Félix-Max présenté tout à l’heure [3]), sis rue Mélingue, qui fabriquaient notamment des visionneuses stéréoscopiques, et ceux de Pierre-Victor Continsouza, à l’angle des rues des Pyrénées et de Belleville, qui produisaient des phonographes et des projecteurs de cinéma (voir l’encadré à la fin du présent texte). Ces deux unités, notons-le donc, appartenaient au même créneau d’industrie : la mécanique optique de précision, comme la L. Gaumont.

Vue idéalisée de l’usine Continsouza sur les hauteurs de Belleville en 1914. © DR

Ouvriers dans un atelier de l’usine de Jules Richard. © Collection Jacques Périn
La vraie opportunité que saisit Léon Gaumont découla de sa rencontre en 1886 de Camille Maillard, la femme qu’il épouserait deux ans plus tard et qui jouerait un rôle décisif dans le lancement de sa carrière. C’est aussi elle qui introduisit son époux à Belleville. Camille était une authentique native de la colline de l’Est parisien, bien enracinée dans le sol bellevillois et, de plus, fille d’une notabilité locale, architecte et conseiller municipal. Ses parents lui avaient constitué une dote très appréciable, formée notamment d’une belle maison d’habitation au 55 de la rue de la Villette [4]. Le jeune couple vint y habiter en 1892. Derrière la maison, un profond jardin d’agrément. En 1896, Mme Gaumont détacha de ce jardin, tout au bout, un lopin de terre pour l’offrir à la société de son mari afin que celui-ci y fasse construire un atelier de fabrication. Il faut bien mémoriser l’endroit car il s’agit du point de départ de l’empire du constructeur Gaumont.
L’atelier des Sonneries
Selon les habitudes transmises par les vieux paysans, ce coin de Belleville était appelé les Sonneries, vocable dérivant peut-être de « saulnerie » (extraction de sel). En voici le plan :

Détail du "Plan parcellaire municipal » de 1895 (quartier 76 : Combat. 132e feuille, PP/11824/E. Archives de Paris, documents numérisés) : le "pays » des Sonneries. En haut, dans la demi-lune, les réservoirs d’eau installés par la Ville de Paris pour l’alimentation de la grande cascade du parc des Buttes-Chaumont. Au-dessous, sur la droite du quadrilatère inscrit entre les rues des Alouettes et de la Villette, colorisée en bistre, la parcelle de la propriété familiale Maillard-Gaumont, avec, au bord de la rue de la Villette, la maison résidentielle (en rouge) et, derrière, le long jardin. Plus bas, en jaune, la ruelle des Sonneries.
Le contexte dans lequel le commerçant Léon Gaumont décida de se faire fabricant est le suivant : à peine devenu chef d’entreprise, il manifesta son ambition de développer le domaine de vente des appareils d’enregistrement et de projection des images animées tel qu’il était au CGP. Là-dessus intervint la présentation publique que Louis et Auguste Lumière firent en 1895 de leur Cinématographe. Elle se passa d’ailleurs en deux temps. L’histoire a surtout sacralisé la suite de projections qui eut lieu au salon Indien du Grand Café sur le boulevard des Capucines à la fin du mois de décembre 1895. C’était tout bonnement une séance ouverte et payante. Au mois de mars antérieur, les industriels lyonnais avaient cependant déjà organisé, cette fois pour le public sélectionné des professionnels — dont Gaumont fit naturellement partie —, une démonstration de leur machine et la cérémonie se déroula exactement dans la salle de la Société d’encouragement où nous tînmes la conférence (voir la note 1). Emouvant, n’est-ce pas ? Cela incita en tout cas le directeur de la Sté L. Gaumont (SLG) à entrer rapidement dans la lice industrielle. Décision d’autant plus pressante à prendre que Demenÿ, dont les affaires personnelles d’entrepreneur périclitaient, peinait dans ses propres recherches en vue de placer sur le marché une machine : le Chronophotographe, du niveau de performance de l’invention des Lumière.
Avant même d’entamer les travaux d’un grand atelier de fabrication au fond du jardin des Sonneries, Léon Gaumont s’installa provisoirement dans un local loué à un voisin bellevillois, M. Garangeot. Là, grâce à René Decaux, l’ingénieur qui dirigeait toute l’équipe des mécaniciens, la finalisation du Chronophotographe s’accéléra et, avec cet appareil, commença dès le milieu de l’année 1896 le tournage de bouts de films à vocation publicitaire.

Le « Chronophotographe » Demenÿ amélioré Gaumont, avec ses accessoires. © Cinémathèque française
Les travaux d’édification de l’atelier définitif furent lancés quelques mois plus tard :

Janvier 1897. Les enfants de Camille et Léon Gaumont jouant dans le jardin de la résidence familiale. Le cliché offre l’intérêt supplémentaire de nous donner à voir, à l’arrière-plan, la carcasse de l’atelier en cours de construction depuis le 15 du mois. © Cinémathèque française

Février 1997. Avancement du montage des structures métalliques. © Cinémathèque française

Avril 1897. Construction de l’intérieur de l’atelier des Sonneries. © Cinémathèque française

Extrait d’une publication publicitaire de la société Gaumont dans les années 1900, un dessin montrant en coupe l’intérieur de l’atelier achevé dans ses différentes parties. D’une surface de 250 m2, il comprend au rez-de-chaussée les bancs d’usinage et d’ajustage de pièces métalliques ; au premier étage, sur la mezzanine, on travaille le bois et l’ébénisterie des coffrets des caméras. Sur la gauche, l’atelier était flanqué d’une longue pièce obscure où s’effectuait la perforation des pellicules cinématographiques ; sur le flanc droite, une extension abrite une forge et une tôlerie pour la fabrication des lanternes. L’énergie motrice des machines est fournie par un moteur à gaz de 10 chevaux. © Cinémathèque française

L’atelier au repos vers 1899. © Musée Gaumont
La douzaine d’ouvriers initialement employée à l’atelier, au printemps de 1897, devint en trois ou quatre ans la quarantaine. Ce qui donne une mesure de la rapidité de la croissance du volume d’activité et de la diversification des travaux industriels de la SLG. Jusqu’à 1908, celle-ci acquit progressivement la propriété de nouvelles parcelles dans la partie ouest de l’ancien terroir bellevillois des Sonneries et dota la fabrication de nouveaux bâtiments, majoritairement de ce côté : l’aile de la rue des Alouettes, pourrait-on dire.
La naissance de la cité Elgé
Ce n’est que l’amorce de la cité qu’on appellera plus tard du nom de Léon Gaumont (en raccourci LG), la cité Elgé, dont le souvenir s’est conservé à Belleville jusqu’à nos jours, longtemps après la démolition de ses bâtiments. En vérité, du reste, la cité Elgé est surtout liée au domaine du tournage des films de fiction et de spectacle, au cinéma, en bref, tel que nous entendons habituellement ce mot. Cette extension des activités de son entreprise en dehors de la fabrication des appareils, Léon Gaumont ne l’avait pas du tout prévue au départ. Il en réalisa cependant la possibilité plus vite que le couple des Lumière et même que tous ses autres confrères.

Alice Guy toute jeune, en 1895. © DR
Une femme exceptionnelle l’y aida, qui se porta à l’initiative pratique de l’orientation vers le « septième art », Alice Guy, modeste secrétaire de direction de la SLG à l’origine, travaillant dans le bureau de son patron en la boutique de la rue Saint-Roch. Elle créa le département artistique de la Gaumont, en prit la direction et s’imposa dans un univers de techniciens et d’opérateurs très masculins. Elle réalisa des centaines de films. Raconter son destin extraordinaire ne pouvant prendre place dans la présente causerie [5], on dira quand même ici que, en 1904 déjà, l’activité de son secteur générait un chiffre d’affaires voisin de celui du domaine de la fabrication des appareils (et le dépassera carrément en 1908).
Chef d’entreprise avisé qui voit où sont les intérêts de sa société, Gaumont, tout en gardant le cap de la fabrication, décida de donner à la production des films des moyens supérieurs. Aux Sonneries, il acquit de nouveaux terrains, cette fois dans la partie est, vers la rue de la Villette. Très vite sera accomplie l’édification d’un très grand studio de tournage, une construction spectaculaire, chef-d’œuvre d’ingénieur, toute de panneaux vitrés insérés dans une armature de fer et dotée à l’intérieur d’équipements techniques sophistiqués. C’était le plus important studio qui existait dans le monde à l’époque et, ce rang, il le gardera jusqu’en 1915. Il entra en fonction en 1905.

Détail d’un dessin autour de 1910 : la verrière du « théâtre de prise de vues », comme on disait à l’origine (la désignation « studio », empruntée aux Etats-Unis, s’imposera plus tard), dans toute sa splendeur. © Musée Gaumont
En 1906-1907, autour de cette cathédrale de verre, seront implantés trois immeubles d’autant d’étages dont les paliers accueillirent le montage des films, la fabrication et le dépôt de décors et costumes, le magasin des accessoires, le coloriage des films à la main ainsi qu’une imprimerie pour la confection des affiches publicitaires de la société Gaumont. Avec la foule des techniciens de plateau , des acteurs et des figurants qui le hantait désormais chaque jour, le domaine bellevillois (que son maître agrandit encore jusqu’à 1912) prit véritablement le tour d’une ruche : la cité Elgé, cette fois, était bel et bien née.

Crédit pour le fond de plan : Archives de Paris, document déjà référencé

L’allée d’entrée/sortie de la cité Elgé aux 53 et 55 de la rue de la Villette. Sur la gauche du cliché, on discerne l’hôtel résidentiel de Léon et Camille ; sur la droite, les immeubles de l’imprimerie et du magasin des décors. Tout au fond, la rue de la Villette. Prise de vue autour de 1912. © Musée Gaumont

Passerelle entre le studio et les magasins des décors et des accessoires. © Musée Gaumont

Prospectus publicitaire Gaumont de 1908. Le dessin, légèrement idéalisé, offre le spectacle de l’extension atteinte par la cité LG à cette date et montre sa bipartition. Au premier plan du cliché, la partie pour ainsi dire fabricante de la cité Elgé, celle d’où sortent les appareils Gaumont, la cité ouvrière, en somme, avec son accès à partir de la rue des Alouettes. Au second plan de l’image, décalée vers la rue de la villette, la partie où se tournent et se réalisent les films, la cité artiste. © Musée Gaumont

12-12 bis rue des Alouettes, entrée « ouvrière » de la cité Elgé, vers 1910. Tout au fond, la rue de la Villette. © Collection Francis Lacassin
Après que la Sté L. Gaumont [6] eut contribué à la mise au point de la machine primordiale de la cinématographie, la caméra-projecteur, la verrière Elgé sera l’un des berceaux du « septième art ».

Chaque jour, plusieurs films étaient simultanément tournés sous la verrière. © Cinémathèque française
Aux boxes divisant le plateau à couvert s’activeront des hommes qui n’étaient à l’origine que des auteurs de scénarios : Louis Feuillade, Léonce Perret et Henri Fescourt, et qui se révèleront être des metteurs en scène de génie, inventeurs des premiers rudiments de la grammaire des films. Recrutés par Léon Gaumont, ils avaient été découverts par Alice Guy pour l’assister (il faut ajouter aux trois cités à l’instant Emile Cohl, pour les dessins animés).

Louis Feuillade, successeur d’Alice en 1907. © Collection Francis Lacassin
Son et couleur
Désormais à la tête d’un domaine à deux faces, Léon Gaumont s’accomplit en chef d’entreprise rigoureux et même un peu sévère [7] : bien qu’il sût déléguer des responsabilités, à Alice Guy par exemple, il avait l’œil de la supervision sur toutes les cellules de vie de sa société, de la comptabilité de gestion et du carnet de commandes jusqu’au choix des scénarios de films.

Stature de patron : Léon Gaumont en 1905. © Musée Gaumont
On le voyait chaque jour partout, des bureaux du comptoir de vente proche de la place Vendôme jusqu’au magasin bellevillois des accessoires de tournage mais jamais autant que dans le bureau d’études des ingénieurs et dans les ateliers de mécanique. Là était le « pré carré » où son implication personnelle était la plus totale ; c’était celui de la recherche de procédés techniques, de l’invention de nouvelles machines et de perfectionnement des précédents appareils. Dans son moi intime, Léon Gaumont restera toute la vie un constructeur avant tout, même si les films assuraient sa fortune.
On l’a dit au début de l’article, dès la première marche de son ascension, Gaumont se fixa le but de travailler à la mise au point de caméras qui enregistrent et projettent les images. Il nourrissait en plus les ambitions spéciales de concevoir et fabriquer des systèmes qui associent aux images le son et la couleur. Aux toutes premières années du XXe siècle, la bataille était déjà fort engagée sur le premier de ces plans parmi les inventeurs et les réalisateurs du monde entier.

Le « Chronophone » Gaumont présenté par une opératrice vers 1901. © Musée Gaumont
Assisté des ingénieurs Léon Frély et Georges Laudet, Léon Gaumont commence dès 1900 à mettre au point dans l’atelier de mécanique de la rue des Alouettes un système qui connecte le Chronophotographe de Demenÿ-Gaumont (présenté tout à l’heure) à un phonographe maison, le Chronophone.
Le dispositif, finalisé en 1902 avec des résultats assez probants, est aussitôt exploité pour le tournage d’une série particulière de films, les Chronoscènes, montrant de grandes vedettes du music-hall de l’époque : Dranem, Mayol… en train de chanter, ou des scènes d’opéra.

Tournage d’une « chronoscène » (en l’occurrence une scène de l’opéra « Roméo et Juliette », de Gounod) dans le studio de verre en 1906. Au premier plan, de dos et au centre entre le « Chronophotographe » et le « Chronophone », que l’on reconnaît bien à sa paire de pavillons, Alice Guy dirigeant les opérations. © Cinémathèque française
Cette attention au son, Gaumont et son équipe la garderont jusqu’à l’arrêt définitif, en 1930, de la fabrication d’appareils à la cité Elgé, cessation d’activité qui coïncidera du reste avec la dissolution de la société Gaumont pionnière et le départ en retraite de son fondateur. Vers 1926, la bataille mondiale des ingénieurs du son en était à la mise au point de la bande sonore, le son directement enregistré sur la pellicule, immédiatement synchronisé avec la prise de vue. Léon Gaumont s’y engagea en association avec les ingénieurs danois Axel Petersen et Arnold Poulsen pour la conception du film, et avec son voisin constructeur de Belleville, Pierre-Victor Continsouza, pour la mise au point de la machine de lecture optique correspondante : le Filmophone.

Le « Filmophone », avec la griffe « G » de Gaumont entre les deux porte-bobines. © Cinémathèque française
Mais ni celle-ci ni les modèles Cinéphone et Idéal qui suivirent n’empêchèrent le système Vitaphone, produit par la major étatsunienne Warner Bros, d’emporter le pompon de la victoire. C’est avec le procédé Vitaphone, nul ne l’ignore, que fut tourné en 1927 Le Chanteur de jazz, consacré premier vrai film parlant de l’histoire.
Tout en sortant, au cours des années suivantes, des versions plus performantes du Chronophone (Chronomégaphone, Elgéphone…), les ateliers de la cité Elgé s’attelèrent à la question de la couleur. Ils concoururent dès 1906 à l’effort international pour la définition du film trichrome qui, en 1911 et 1912, permit à Léon de breveter, sous le nom de Chronochrome, un nouveau projecteur à la pointe du progrès.

Superbe machine, le « Chronochrome ». © Cinémathèque française
Immédiatement exploité dans la grandiose salle de projection publique Gaumont Palace ouverte en 1908 près du cimetière de Montmartre, l’appareil, cependant, ne conserva pas longtemps, dans ce domaine également, le leadership, concurrencé qu’il fut par l’arrivée en rafale de modèles étrangers. Américains, surtout.
Impact populaire de la cité Elgé à Belleville
Une ruche aussi vibrante que la cité Elgé a bien sûr fait présence dans la population bellevilloise. Encore qu’il soit difficile de le préciser, beaucoup d’ouvriers du cru y furent embauchés, à la mécanique et plus encore pour le tournage des films : le montage était alors un travail presque exclusivement féminin. Quantités de Bellevillois étaient aussi employés comme figurants ; certains, repérés par Feuillade ou Perret, devinrent des vedettes du jeune écran, Suzanne Arduini (qui sera plus tard connu comme Suzy Prim) par exemple ou Bout de Zan, peut-être le premier enfant prodige du cinéma [8].

Bout de Zan (René Poyen à la ville) sous la caméra de Louis Feuillade en 1913. © Collection Francis Lacassin
De la cité Elgé, si dense que fut son empreinte pendant une vingtaine d’années, il ne reste plus rien aujourd’hui. Dès les lendemains de la Ire Guerre mondiale, le studio bellevillois était déjà vétuste, ses équipements, démodés, surclassés. Les réalisateurs, ceux de Gaumont comme ceux de Pathé, du reste, préférèrent louer des sites de tournage ailleurs, à Nice ou, en région parisienne, à Saint-Maurice-sur-Marne, par exemple. La partie fabrication, on l’a dit tout à l’heure, disparut avec le départ de Léon Gaumont à la retraite, en 1930. Les locaux, qui subirent du reste un incendie ravageur, furent en partie loués après 1950 par la société de télévision SFP, qui les quitta à son tour à la fin des années 1990.

An 2000, le trou où était la cité Elgé. © Maxime Braquet
Démolition finale, immeubles de remplacement dans un urbanisme bien différent. Pas même une inscription pour raconter l’histoire ancienne du lieu, juste une plaque de rue vaguement évocatrice : cour du Septième-Art. Des associations de quartier se battent pour que naisse une rue Alice-Guy. Le seul souvenir visible de Léon Gaumont à Belleville se réduit finalement à… sa tombe dans l’ex-cimetière communal de la rue du Télégraphe [9].
Maxime BRAQUET
Hommage à Pierre-Victor Continsouza
Léon Gaumont ne fut pas le seul pionnier de l’appareillage cinématographique à Belleville. Il y eut aussi Pierre-Victor Continsouza, installé pour sa part dans le sud de ce territoire parisien et à qui il arriva d’ailleurs de travailler pour son voisin des Buttes-Chaumont. S’il ne jouit pas de la même notoriété que ce dernier, cela tient principalement au fait qu’il ne s’est pas lancé, quant à lui, dans l’entreprise du cinéma en images dans une sorte de "Cinecitta" à la bellevilloise. Pour le reste, la participation de cet industriel à l’accouchement collectif de la machine cinéma autour de 1900 ne souffre aucune contestation.

Pierre-Victor Continsouza, ici âgé. © DR
Elle s’est marquée surtout dans le domaine de la conception et de la fabrication des projecteurs. En commun avec son associé René Bunzli, il fit breveter un système d’entraînement des images grâce à l’action d’un mécanisme en forme de croix de Malte à quatre branches qui, d’excellente facture, fut utilisée par d’autres constructeurs.
Corrézien de naissance, Pierre-Victor Continsouza fit son initiation générale à la mécanique à l’Ecole d’horlogerie de Paris, au 30 de la rue Manin [10], et ses classes de mécanicien de précision à l’usine de ce Jules Richard évoqué plus haut dans cet article. Enraciné dans le Grand-Belleville, il forma en 1895 une société avec l’ingénieur René Bunzli, la B&C, et ouvrit l’an suivant un premier atelier en la rue de la Fontaine-au-Roi, artère du bas Belleville occidental.

Pavé publicitaire inséré dans l’édition 1899 de l’"Annuaire-almanach » Bottin-Didot.
Entre 1897 et 1909, cette entreprise entra dans un montage de sociétés qui comprenait aussi celle des frères Pathé. Sous le nom de Manufacture française d’appareils de précision (MFAP), elle vint s’installer au 25 du boulevard de Belleville [11], au carrefour des Couronnes.
Dès cette époque, Continsouza noua avec Pathé des relations d’affaires privilégiées voire exclusives. C’est de l’unité des Couronnes que sortirent les premiers modèles de projecteurs portant avec succès la marque du coq : le Robuste (1902), le Pathé renforcé (1905) et le Pathé professionnel (1908).

Le projecteur « Le Robuste » de marque Pathé. © Cinémathèque française
En 1909, M. Continsouza (séparé en même temps de René Bunzli) reprit son indépendance juridique tout en intégrant de nouveaux locaux sur le plateau de Belleville à la villa Faucheur (rue des Envierges). Il y continua à œuvrer pour Pathé sans lui réserver dorénavant l’exclusivité. En 1914, il agrandit son installation bellevilloise qui revêtit alors la dimension d’une véritable usine. La suite du parcours de l’industriel Continsouza, nous la racontons, sur le même présent Website, à : https://www.des-gens.net/Cour-de-la-Metairie
M. B.
Bibliographie générale
* Les Premières Années de la Société L. Gaumont et Cie. Correspondance commerciale de Léon Gaumont, 1895-1899, par Marie-Sophie Corcy, Jacques Malthête, Laurent Mannoni… ; textes de Corine Faugeron, Laurent Mannoni et Jean-Jacques Meusy, éd. de l’ Association française de recherche sur l’histoire du cinéma, 1999. Lisible uniquement dans les bibliothèques de recherche, BNF, BHVP…
** Alice Guy, Léon Gaumont et les débuts du film sonore, sous la direction de Maurice Gianati et Laurent Mannoni, éd. New Barnet : John Libbey Publishing, 2012.
[1] Une biographie véritable de Léon Gaumont, d’un homme au parcours de vie plutôt extraordinaire, une telle entreprise, c’est assez incroyable à dire, n’a pas encore tenté un spécialiste et reste à faire. Des ébauches comme celle que nous dessinons ici, il en existe dans les nombreux ouvrages consacrés à la société de cet industriel et on trouvera d’autres éléments sur Wikipédia.
[2] Sa part personnelle est de 50 000 francs, égale à celle Gaumont ; l’astronome et alpiniste Joseph Vallot est majoritaire avec 75 000 francs et Alfred Besnier complète de 25 000 francs ; soit un total de 200 000.
[3] Selon le biographe de Jules Richard, Jacques Périn (« Jules Richard et la magie du relief », 3 tomes, éd. Cyclope, 1993, et Prodiex, 2001), Léon Gaumont eut avec cet industriel un entretien d’embauche vers 1892 qui se déroula très mal. Comme Félix-Max était par ailleurs en fort mauvais termes avec son aîné, il est possible que l’envie de le narguer entre dans les raisons qui présidèrent à l’engagement de Léon Gaumont au CGP.
[4] Ce bâtiment fut très probablement élevé par le père de Camille dans les années 1870.
[5] Se reporter alors à « Autobiographie d’une pionnière du cinéma : 1873-1968 / Alice Guy », éd. Denoël, 1976. Accessible à la bibliothèque municipale spécialisée François-Truffaut, au forum des Halles.
[6] Elle deviendra société anonyme en 1906 sous le nouveau nom de Société des établissements Gaumont (SEG).
[7] Dans son livre de mémoires, La Foi et les montagnes, Henri Fescourt, présenté plus haut, témoigne : « Tout d’abord, on entrait dans l’usine [par le 53-55, rue de la Villette], on remarquait sur la droite le pavillon privé de M. Gaumont et sa famille. On se sentait aussitôt saisi par une présence, une domination. »
[8] A propos de Suzanne Arduini, voir, sur ce site Web même, notre article « Gaston, Suzy, Camille, Michel, Georges et les autres ». Pour Bout de Zan, toujours sur le site présent, l’article « Les Aventures de Bébé et de Bout de Zan ».
[9] Sans quitter la présente station Web, voir notre article « Léon et Camille Maillard ».
[10] Aujourd’hui ouverte au 61 de la rue David-d’Angers, 19e.
[11] Exactement à l’emplacement du magasin actuel Darty.